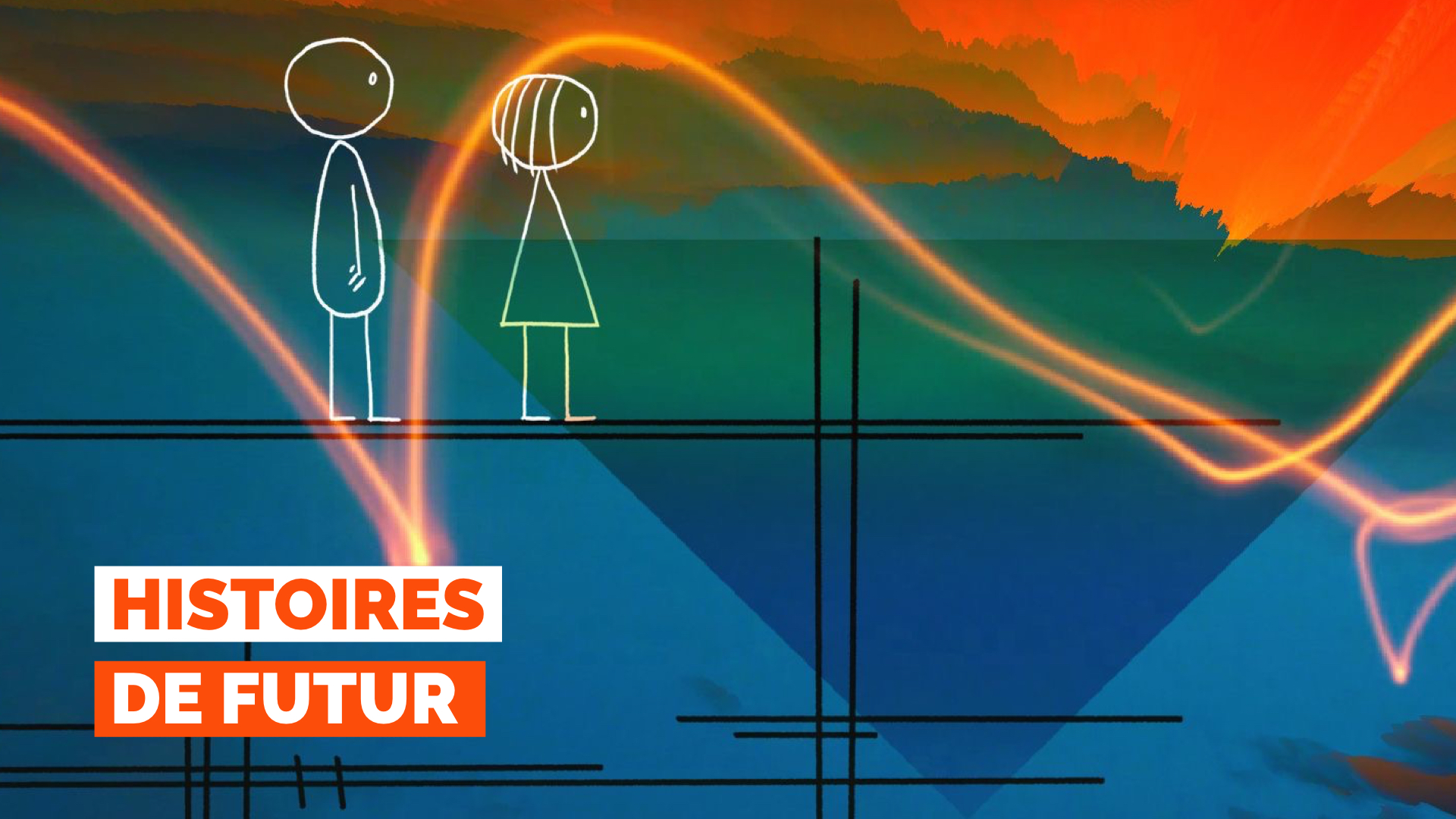Une prospective-fiction pour réfléchir au bonheur dans l’entreprise. On imagine, on discute… On agit.
Pour vous, cette anticipation est probable ou non probable ? Souhaitable ou non souhaitable ? A vos réponses.
Heurts et bonheurs de l’entreprise heureuse
Nous sommes en 2037. L’entreprise heureuse a pour finalité de fournir du bonheur et une vie joyeuse et saine à ses collaborateurs. Arthur Getz, le patron de Félicity, raconte les aléas inhérents à ce changement de cap dans son entreprise.
Dans son livre « L’entreprise heureuse », Arthur Getz annonce d’entrée de jeu qu’il a surfé sur la vague du bonheur en entreprise qui déferlait depuis une quinzaine d’années.
En 2016, on voit l’arrivée des responsables du bonheur en entreprise ou plutôt Chief Happiness Officier. La dénomination anglophone donne un peu de sérieux à ces animateurs de gouters. Ces chantres du bien-être vendent des décors colorés, des espaces de sieste et des tables de ping-pong. Les plus aventureux militent pour que les collaborateurs retrouvent leurs émotions d’enfants avec des salles de réunion en Lego, des petites voitures à pédales et des toboggans.
En 2022, cette cosmétique de l’enchantement provoque des débats philosophiques de cantine. Face à l’engouement, les détracteurs affirment que le bonheur résiste dans la capacité de chacun à déguster l’instant. L’extase se produit lorsque la pensée, les paroles et les actes d’un individu sont en harmonie. L’entreprise n’a donc rien à voir avec cette aventure individuelle. Selon Arthur Getz, les pourfendeurs du bonheur en entreprise résument leur opposition en considérant que « Le bonheur est une question trop importante et trop personnelle pour que l’individu en confie la responsabilité à d’autres, et notamment à son entreprise ».
Pendant ce temps, les patrons se frottent les mains. « Disserter sur le sujet confère au bonheur en entreprise une valeur assez forte pour pouvoir en son nom en demander encore plus aux collaborateurs », explique Arthur Getz en précisant qu’au nom du bonheur, ils piétinent allégrement la vie privée de leurs collaborateurs. Pour eux, cet humanisme bon teint est une source de performance économique. Après avoir tiré sans réserve sur les prix, les coûts, les hommes, ils voient là un nouveau gisement de productivité. Autre avantage, les dépenses en « déco » bien-être sont vite amorties par une diminution sensible de l’absentéisme.

C’est dans ce climat qu’Arthur Getz, le patron de Felicity, jette un pavé dans la marre avec l’entreprise heureuse. En janvier 2031, le fils d’un penseur de l’entreprise libérée invite Aristote à un mémorable HolloNote[1]. Le philosophe de l’antiquité répète que : « Le bonheur est le bien suprême qui rend négligeable toutes autres formes de possession. » Le patron décrète ensuite que la finalité de son entreprise n’est plus économique, mais est désormais de donner une vie heureuse et saine à ses collaborateurs. Gagner de l’argent devient juste un moyen comme un autre de contribuer au bonheur des collaborateurs.
Lors de l’événement, Arthur Getz accueille ensuite Robert Kennedy. Le sénateur américain affirme que : « Le produit national brut mesure tout sauf ce qui donne valeur à la vie. » Pour éviter cet écueil, le Patron de Félicity lance le BIB (Bonheur intégral brut). Cet indicateur mesure le bonheur collectif. À cause de phénomènes naturels de contagion de bonheurs, le BIB est supérieur à la somme des bonheurs individuels. Il est aussi pondéré par une variable de possession qu’Arthur Getz explique par le fait que : « Le bonheur est la seule chose qu’on peut donner sans l’avoir et acquérir en le donnant. »
Pour mesurer le bonheur individuel, il envisage plusieurs dispositifs. Le premier est le déclaratif. Chaque collaborateur doit indiquer chaque jour son niveau de bonheur sur une échelle de 1 à 10. Si le premier mois, tous prennent un temps pour s’interroger, ils finissent par opérer machinalement et répéter le même chiffre.
Felicity investit alors dans un système d’intelligence artificielle apprenant de reconnaissances de sourires. Au bout d’un mois, c’est le branle-bas dans l’entreprise. Nombreux collaborateurs ne supportent plus de croiser des momies aux zygomatiques tenus par des élastiques. Ils ont même des envies de refaire le portrait des forçats du sourire.
Arthur Getz tente alors de mesurer le bonheur par la détection des propos positifs dans les échanges verbaux et écrits entre les collaborateurs. Cela tourne rapidement au « bisounoursage » généralisé avec échanges de propos loukoum, sucrés et dégoulinants de mièvreries. Quand des attaques anonymes commencent à polluer l’entreprise, Arthur Getz effectue un nouveau HolloNote où il affirme : « Le bonheur n’est pas une affaire quantitative. Il résulte de la capacité de chacun à se soucier des autres, oser pour les autres, partager avec les autres. » La pirouette est bien accueillie. Les collaborateurs sont trop heureux de pouvoir garder des sourires pour se moquer des jours sans joie.
[1] HolloNote : Keynote avec projections holographiques permettant aux intervenants d’être présent à plusieurs endroits et d’échanger avec des personnes disparues.

Parallèlement au BIB, Arthur Getz change les procédures de recrutement. La priorité est d’engager des gens doués pour le bonheur. Cette disposition n’étant pas validée par des diplômes, ils font appel à la science. Comme elle ne certifie pas la capacité au bonheur de ceux qui possèdent les dents du bonheur[1], ils se tournent vers la génétique. Elle affirme que la capacité au bonheur est liée à 50 % au patrimoine génétique sans pour autant identifier les gènes du bonheur.
Des collaborateurs montent alors au créneau pour dire que ne recruter que des gens heureux est une forme de discrimination. Si la capacité au bonheur devient un critère de recrutement, on va vers une société à deux vitesses. On aura des heureux de plus en plus heureux et des malheureux de plus en plus malheureux, car ils n’auront pas de travail. On ne peut donc pas exclure ceux qui ne sont pas doués pour le bonheur et qui même, mettent une jouissance à faire leur propre malheur. Il en est de même de ceux qui n’ont pas été bien servis par la vie et ne font pas preuve de résilience. Ils affirment en plus que c’est pratiquer la double peine parce que les individus malheureux sont souvent tristes de ne pas être heureux.
Un peu échaudé par ces oppositions, Arthur Getz demande à ses collaborateurs quelles sont les composantes du bonheur incontournables pour l’entreprise heureuse. Outre la santé, la sécurité financière, ils insistent sur la liberté et le pouvoir décision. Le patron décide donc de permettre aux salariés de l’entreprise de travailler quand ils veulent, comme ils veulent, avec qui ils le désirent. La seule contrainte est qu’ils soient vraiment heureux dans ce qu’ils font.
Le ratio habituel de ceux qui ne jouent pas le jeu est respecté. Entre 2 et 5 % des collaborateurs deviennent des lézards qui, dans le meilleur des cas, viennent profiter des terrasses de l’entreprise pour se dorer la pilule. Les autres ont profité pleinement du désalignement de leur travail pour collaborer, voyager, découvrir, innover. Très rapidement, l’entreprise fait des résultats assez satisfaisants pour rémunérer tous les collaborateurs et assurer sa pérennité. Le PDG de Felicity en tire une première conclusion : « Pour travailler dans le bonheur, travaillons chaque jour notre bonheur ».
Alors que les propos manquent cruellement de consistance voire d’intelligence, ils font sortir de l’ombre des collaborateurs nourris à un syndicalisme suranné. Ils partent à l’attaque en affirmant que la priorité au bonheur pousse à l’égoïsme et supprime toutes formes d’altruisme. Ils estiment que cela enlève la possibilité d’être malheureux par choix. Ils citent des personnages comme Nelson Mandela qui a passé 27 ans en prison pour lutter contre l’apartheid, Jésus qui a été crucifié pour sauver le monde. Pour eux, le malheur des uns peut aussi faire le bonheur des autres. D’autres opposants à l’entreprise bonheur considèrent que le malheur est souvent un pont vers le bonheur. On a conscience d’être heureux parce que l’onconnaît le malheur. Ils estiment aussi que l’homme vaut bien mieux que son bonheur.
Arthur Getz prend alors conscience qu’en érigeant en norme le fait d’être heureux au travail, il devient impossible de dire ou montrer qu’on ne l’est pas. Il réagit en parlant désormais d’entreprise respectueuse. Dans cette entreprise, on respecte la diversité des approches. Le bonheur n’est plus un mets obligatoire, mais il est en libre-service et chacun peut l’aménager à sa sauce.
[1] Dents écartés